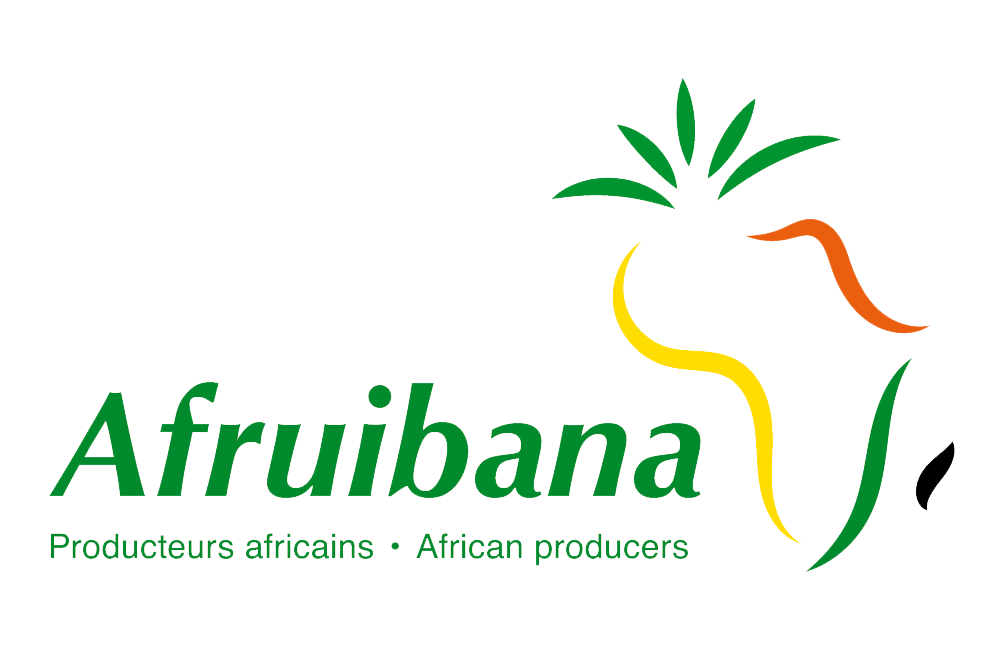3 questions à , Raphael Belmin, chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) accueilli à Dakar à l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA)
Vous êtes basé à Dakar et travaillez sur les nouveaux modèles de culture durables. Selon vous, la pandémie de Covid-19 va-t-elle accélérer la transition des modèles agricoles africains vers des modèles plus durables ?
Il n’y a pas de réponse facile à donner, on ne peut savoir de quoi l’avenir sera fait, mais certains signes laissent penser que cette crise a déclenché une prise de conscience.
L’agriculture africaine est globalement dans une impasse car confrontée à des défis difficiles à concilier : alimenter les populations dans un contexte de croissance démographique très élevée, s’adapter aux changements climatiques et lutter contre la dégradation des ressources de base (eau, sols, forêts…). Dans ce contexte, le modèle agricole actuel, basé sur l’intensification chimique n’apporte pas de réponse durable. Les systèmes de production conventionnels, même s’ils paraissent performants à court terme, sont en fait bâtis sur des fondations fragiles du fait de leur dépendance aux intrants exogènes (fertilisants, pesticides…) et de leur faible résilience face aux changements climatiques et aux bioagresseurs.
Il faut aujourd’hui changer de paradigme, changer nos manières de produire, échanger et consommer. C’est le diagnostic, mais aujourd’hui, alors qu’un nombre croissant d’acteurs se mobilisent pour une autre agriculture (ONG, Think Tank, associations de producteurs…), la situation évolue difficilement. On connait déjà les grandes voies d’innovation qu’il faudrait bâtir pour rendre l’agriculture plus durable. De nombreuses solutions sont en voie de développement ou déjà opérationnelles, que ce soit dans le domaine de la fertilité des sols, de la lutte biologique ou de l’agroforesterie.
On constate pourtant l’existence de freins très profonds qui s’opposent au changement, voire des phénomènes de verrouillage. Ces derniers sont liés au fonctionnement des filières, aux systèmes de conseils souvent dominés par des acteurs privés, et enfin aux politiques publiques qui ne sont pas systématiquement favorables au développement de l’agroécologie malgré le fait que les discours aillent dans ce sens. Par exemple, au Sénégal, le gouvernement est favorable à l’idée d’une transition agroécologique mais les politiques nationales ne vont pas suffisamment loin dans ce domaine : elles se limitent à la reforestation du territoire quand la transition agroécologique appelle des transformations beaucoup plus profondes et des interventions multisectorielles. En parallèle, on continue à subventionner les fertilisants minéraux.
Pour rendre l’agriculture africaine plus durable, il organiser le grand déverrouillage, un véritable changement systémique : changer nos manières de produire et diffuser les connaissances agronomiques, réorganiser les territoires et instaurer une nouvelle manière de gérer les ressources naturelles. Je pense notamment à la question de l’eau. Dans la zone des Niayes au Sénégal (une région productrice de fruits et légumes), il y a de fortes tensions sur les ressources en eau, ce qui laisse présager une disparition de l’agriculture dans les prochaines décennies. Il faut donc repenser la manière d’utiliser et partager l’eau dans un contexte où les usagers sont de plus en plus nombreux.
Pour revenir sur la crise de Covid, je pense qu’elle stimule la prise de conscience politique, car elle met en évidence la fragilité des systèmes de production et des systèmes alimentaires. Il suffit d’un virus de quelques micromètres pour bousculer tout le système. On a vu dans plusieurs pays des producteurs qui avaient des difficultés à vendre leurs récoltes ou leurs produits d’élevage. On a également vu poindre des risques d’envolée des prix des matières premières agricoles similaires à la situation de 2008. La crise Covid a entrainé une prise de conscience politique sur la nécessité de relocaliser les systèmes alimentaires, de les rendre moins dépendants de l’extérieur et tendre vers une souveraineté alimentaire. Mais, comme expliqué précédemment, le système est verrouillé et ce n’est pas uniquement le fait des politiques publiques. On peut donc se questionner sur les changements réels que la crise sanitaire va générer.
Je suis convaincu que la transition agroécologique, comme projet politique, peut-être réellement une opportunité pour construire le monde d’après Covid. Dans des pays comme le Sénégal, la société civile, les centres de recherche, les collectivités territoriales et le gouvernement sont fortement engagés dans ce sens. Il y a notamment un mouvement qui s’appelle la DyTAES (Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal) qui a émergé en 2019 et qui vise à accompagner l’Etat sénégalais dans la construction d’une politique de transition vers l’agroécologie.
En conclusion, tous les éléments sont là pour construire le monde d’après mais les systèmes agricoles et alimentaires sont marqués par une forte inertie. Face à cette situation, il faut espérer que la crise sanitaire soit l’étincelle qui favorise la prise de conscience politique et donne plus de moyens pour agir en faveur de la transition.
Quelles sont, selon vous, les perspectives qui s’offrent à l’agroécologie en Afrique ?
La transition agroécologique, en Afrique subsaharienne, n’empruntera pas forcément la même voie qu’en Europe. On réalise aujourd’hui que dans le contexte africain, le recours aux marchés de niches rémunérant mieux les produits écologiquement responsables n’est pas l’unique alternative. D’autres leviers plus adaptés à la situation africaine peuvent être activés.
Avec de nombreux collègues du CIRAD, nous faisons le pari que les systèmes de culture agroécologiques, si on les travaille bien, deviendront à long terme plus productifs et rentables que les systèmes traditionnels car plus résilients, moins dépendants des intrants exogènes et avec une production plus régulière et concentrée dans l’espace. Plusieurs expériences de terrain, menées par des ONG ou des centres de recherche, ont par exemple mis en lumière que les produits issus de l’agroécologie se conservent mieux. Or la qualité de conservation est un facteur de compétitivité important car il y a beaucoup de pertes dans les chaines de valeur sur le continent africain. Les producteurs qui passent en agroécologie se rendent compte qu’ils ont un avantage vis-à-vis des autres producteurs dits conventionnels : leurs produits se conservant mieux, ils sont privilégiés par les acheteurs. Donc d’une part, même s’il n’y a pas de surprix attribué aux produits issus de l’agroécologie, les producteurs écoulent plus facilement leurs stocks et ont moins de risque que leur produit s’altère avant d’avoir été vendu et soit ainsi perdu.
Mais pour réussir dans le domaine de l’agroécologie, les chercheurs doivent impérativement revoir leurs manières de concevoir de nouveaux systèmes. Beaucoup d’échecs dans les projets de transition agroécologique sont liés au fait que l’on teste les techniques séparément les unes des autres. Il faut au contraire concevoir des systèmes de culture intégrés, intelligents, en employant tous les leviers possibles : le variétal, la fertilité des sols, la lutte biologique, la protection physique des cultures, les pesticides naturels, l’association entre plusieurs cultures dans l’espace, les rotations, la réintroduction des arbres dans les parcelles, l’intégration culture/élevage… Les instituts de recherche doivent continuer à travailler ces systèmes de manière à ce que, sans même qu’il y ait un marché un de niche, les producteurs passent en agroécologie sans prendre trop de risques.
Pour réussir la transition agroécologique, il est également indispensable que les Etats réinvestissent dans le conseil agricole. Au Kenya par exemple, le conseil est organisé par des firmes agro-semencières en compétition les unes avec les autres et souvent structurées à l’échelle internationale. Elles se déploient dans le pays en organisant des réseaux de distribution qui maillent le territoire de manière extrêmement fine. Par l’intermédiaire des « agrovet » (nom des boutiques de distribution d’intrants), chaque producteur a accès à une gamme de pesticides chimiques et à des conseils pour leur utilisation. L’État Kenyan semble passif car ce système permet à court terme le maintien de la production. Mais c’est sans compter l’impasse dans laquelle ce modèle agricole mène les agriculteurs (phénomènes de résistance, efficacité de plus en plus faible…).
L’émergence d’outils agricoles modernes et l’optimisation croissante de la data agricole, permettent-ils aujourd’hui d’apporter un réel soutien aux agriculteurs d’Afrique de l’Ouest? Comment faire en sorte que ces outils soient plus appropriables pour les exploitants africains?
La « data agricole » est un mot valise dans lequel on peut mettre plein de choses différentes. Ce qui est certain, c’est que c’est la voie d’innovation dominante en ce moment. Le CIRAD est d’ailleurs fortement impliqué. Par exemple, certains de mes collègues développent des outils d’estimation du rendement des mangues et d’autres arbres fruitiers à partir de photographies prises dans les vergers, par drone et par satellite. C’est un exemple parmi tant d’autres.
Ma préoccupation est de savoir qui seront les bénéficiaires de la data agricole ? Cette question se pose pour l’Afrique car l’agriculture y est profondément duale. On trouve d’un côté une agriculture familiale extrêmement dominante en matière de surface et de population concernée ; de l’autre, on trouve l’agrobusiness, une forme d’agriculture fortement capitalisée gouvernée par des investisseurs. Je perçois un risque que la data agricole serve uniquement à l’agrobusiness, car ce marché est plus rémunérateur pour les entreprises qui développent des outils basés sur la data agricole. On trouve tout de même des exemples d’outils adressés directement à l’agriculture familiale. Par exemple, les Systèmes d’Information Climatique (SIC) se basent sur des modèles météorologiques pour envoyer des SMS ou messages vocaux à des petits producteurs afin de les prévenir de l’arrivée d’une pluie ou d’une sécheresse. Les producteurs utilisent ces informations pour planifier leurs dates de semis. C’est un remarquable outil d’adaptation au changement climatique car ces pays sont très impactés par la variabilité climatique et les évènements extrêmes. Au Sénégal notamment, l’irrégularité de la pluviométrie est un problème majeur affectant au quotidien les exploitants. Avec ce type d’outil, ils voient le niveau d’incertitude diminuer. Les SIC sont des exemples de bonnes pratiques d’utilisation de la data agricole au service des producteurs africains.